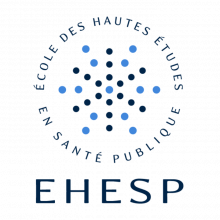L'article complet de Fabienne Orsi à lire sur le site www.encommuns.net "A la recherche d'un autre modèle de soin"
Voici le récit d'une initiative unique en France portée par la direction d'un Centre Hospitalier Universitaire. Dans ce long entretien conduit par Fabienne Orsi, François Crémieux et Johanne Menu retracent avec détails leur engagement pour le déploiement de centres de santé "hors les murs" de l'hôpital pour lutter contre les déserts médicaux. Ce faisant ils nous livrent une vision renouvelée du service public hospitalier qui s'étend et s'invente.
Introduction par Fabienne Orsi
François Crémieux est directeur général de l'Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille (AP-HM). Johanne Menu était, jusqu'à récemment, directrice adjointe à l'hôpital Nord et directrice des centres de santé de l'AP-HM . Cet entretien a été conduit dans la perspective de nourrir une recherche en cours sur les voies possibles permettant de repenser la notion de soin ainsi que celle de modèle de soin . Il est clair désormais que le système de santé français est à un tournant. L'accès aux professionnels de santé se dégrade, les déserts médicaux se multiplient, le soin psychique connaît une crise sans précédent, les hôpitaux publics doivent notamment faire face à des niveaux d'endettement historiques. Les jeunes professionnels sont de moins en moins enclins à travailler dans des conditions de travail dégradées. Il s'agit par ailleurs de répondre à l'explosion des maladies chroniques (obésité, maladies cardiovasculaires, cancers, diabète...) liée en partie au vieillissement de la population, mais également aux activités de l'agro-industrie et de l'industrie chimique (produits alimentaires ultra-transformés, polluants éternels, pesticides, microplastiques, etc.), dont les impacts sur l'environnement et sur la santé humaine ne cessent de se confirmer .Les réponses des gouvernements successifs s'avèrent rarement à la hauteur de l'enjeu tant les impasses et les controverses sont nombreuses comme en atteste la teneur des débats récents autour du projet de loi Garot proposant de réguler une partie de l'installation médicale ou encore de la Loi Duplomb réintroduisant notamment l'usage des néonicotinoïdes, des pesticides toxiques interdits depuis 2018 .
Bien soigner impose, certes, un nombre suffisant de professionnels de santé partout sur le territoire. Toutefois, cela nécessite aussi de s'interroger sur ce que soigner veut dire aujourd'hui, sur la pratique du soin que l'on souhaite, sur les organisations et les modes de financement qui la portent et la façonnent. Soigner ne saurait être pensé sans s'inscrire dans un autre projet de société, sans envisager une autre façon d'habiter le monde. Çà et là, des initiatives se prennent et nous invitent à les suivre.
C'est dans cette perspective de soigner autrement que les centres de santé font aujourd'hui l'objet d'une attention particulière.
Comme nous le verrons dans l'entretien, les centres de santé ne sont pas une idée neuve. Ils sont souvent situés comme les héritiers des dispensaires. En France, les premiers centres de santé ont été créés à l'initiative de quelques municipalités et de certains acteurs du mouvement mutualiste au moment du Front populaire et dans l'après Seconde Guerre mondiale. Certains de ces centres étaient porteurs d'un modèle alternatif de soin fondé sur les principes d'une médecine sociale inscrite dans une logique d'insertion dans la vie des quartiers avec un véritable projet de transformation sociale . Cependant, leur développement est resté relativement confidentiel, le modèle de soin français s'étant largement institué à partir d'une médecine de ville libérale au paiement à l'acte d'un côté et d'une activité hospitalière d'établissement de l'autre. Depuis plusieurs années cependant, les centres de santé en tant qu'entité juridique, reviennent sur le devant de la scène comme "structure de soins primaires de proximité" . Ces centres doivent répondre à certains principes dont l'accès inconditionnel, l'activité salariée, la pratique des tarifs dits de secteur 1, c'est-à-dire sans dépassement d'honoraires. Néanmoins, tous les centres de santé ne s'inscrivent pas dans une logique de médecine sociale inspirée des premiers centres de santé ou d'une logique de santé dite "communautaire" .
Seul un petit nombre de centres de santé s'inscrit dans cette dynamique. Ces centres sont à l'initiative la plupart du temps de collectifs désireux de changer leur pratique du soin, d'aller vers et faire avec les habitants du quartier, dans une démarche non exclusivement curative et médicale, mais également sociale fondée sur la prévention et la prise en compte de facteurs écologiques, sociaux et économiques avec la volonté également d'être financés autrement que par le paiement à l'acte. Hormis ces quelques centres de santé communautaire , la plupart des centres de santé ont une activité somme toute classique. Et, si leur gestion est principalement associative, les centres de santé font désormais l'objet d'un investissement croissant de la part de groupes privés lucratifs tel que le groupe Ramsay Santé dont il sera également question dans l'entretien. Bien que les hôpitaux publics soient légalement autorisés à créer et gérer des centres de santé depuis plusieurs années, cette pratique ne s'est jusqu'ici jamais développée.
Une expérience unique, qui pourrait peut-être essaimer ailleurs.